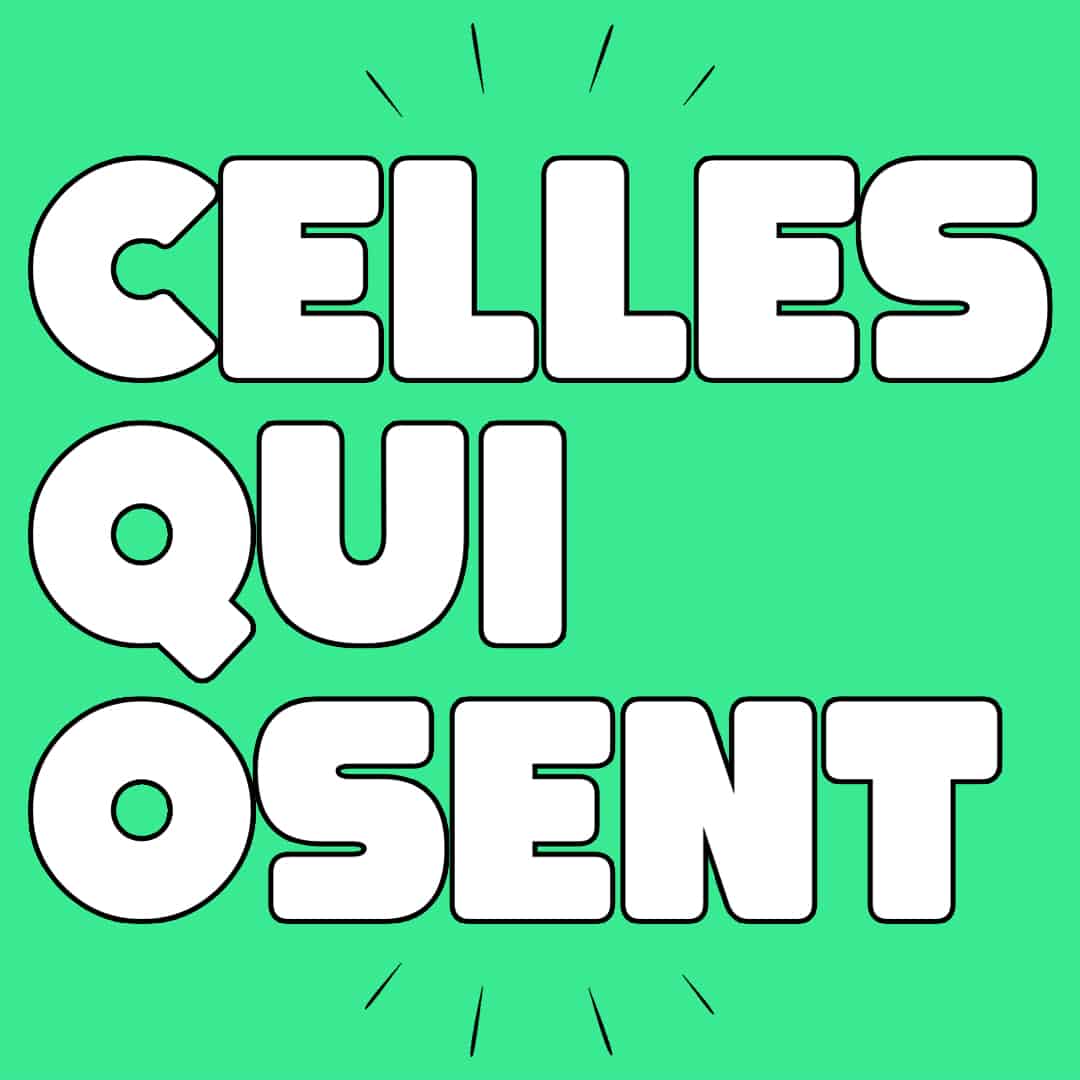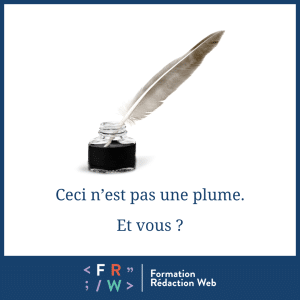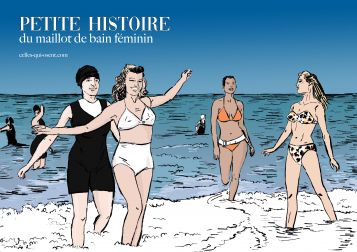Olympe de Gouges : une féministe dans la tourmente de la Révolution française
Injustement censurée au XVIIIe siècle, Olympe de Gouges est enfin ressortie des oubliettes de l’Histoire. Cette autrice de pamphlets et de pièces de théâtre engagées s’est illustrée durant la période trouble de la Terreur. Ses prises de positions politiques et son audace lui ont coûté la vie : elle est en effet la seconde femme guillotinée en France après Marie-Antoinette. Sa célèbre Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, témoigne de son implication dans le mouvement féministe naissant.
Retour sur le destin tragique de cette militante à l’époque de la Révolution française.
Une héroïne de la Révolution française
Le parcours d’une femme de lettres éprise de liberté
Olympe de Gouges, de son vrai nom Marie Gouze, naît le 7 mai 1748 à Montauban, au sein d’une famille bourgeoise. Non reconnue à la naissance, elle serait la fille adultérine de Jean-Jacques Lefranc de Pompignan, un poète et dramaturge toulousain. Sa mère, Anne-Olympe Mouisset, fille d’avocat, est l’épouse d’un maître boucher.
À dix-sept ans, comme beaucoup de jeunes filles de son époque, elle est contrainte au mariage forcé. Elle déclarera plus tard ne pas avoir aimé son mari Louis-Yves Aubry, et l’avoir même trouvé odieux et répugnant (Mémoires de madame de Valmont). Quelques mois plus tard, elle donne naissance à un fils, prénommé Pierre.
En 1770, lasse de sa situation, la jeune provinciale quitte le domicile conjugal et trouve refuge à Paris. Prenant le nom d’Olympe de Gouges, elle veut mener la vie la plus libre possible. Et si elle refait sa vie avec Jacques Biétrix de Rozières, un haut fonctionnaire du ministère de la Guerre, elle ne se remariera jamais.
Pourtant, à l’époque, les femmes célibataires ou en union libre sont très mal vues. Avant-gardiste, Olympe assume son indépendance avec fierté.
« Le mariage est le tombeau de la confiance et de l’amour »
écrira-t-elle dans la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne.
Olympe a reçu peu d’instruction durant l’enfance. Elle mise pourtant sur l’écriture pour défendre les causes qui lui sont chères. La jeune femme s’intègre aux salons littéraires parisiens et commence à écrire des pièces de théâtre engagées.
Révoltée par la traite esclavagiste, elle devient l’une des premières figures publiques à s’opposer à ce système très lucratif. En 1784, elle rédige Zamore et Mirza ou l’heureux naufrage, première pièce de théâtre française critiquant le sujet. Jugée trop dérangeante par certains aristocrates influents, cette œuvre ne sera pas jouée avant la Révolution.
Tout au long de sa carrière d’écrivaine, Olympe de Gouges s’attaquera à un grand nombre de sujets sensibles. Ses thèmes de prédilection sont la lutte contre la pauvreté et l’oppression, la défense des droits de la femme ou de l’enfant. On lui attribue à ce jour seize pièces de théâtre, un roman autobiographique et plus de cinquante écrits politiques.
Un combat inégal contre la Terreur
Lorsque la Révolution française éclate en mai 1789, Olympe accueille le mouvement avec enthousiasme. Assoiffée de justice sociale, elle est séduite par les idéaux républicains. Mais le 26 août, avec l’adoption de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, c’est la douche froide. Ce texte juridique ne s’adresse qu’aux citoyens, c’est-à-dire les hommes.
En réaction, l’écrivaine rédige sa propre Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791. Imitant la forme et le ton de son modèle, son article premier proclame :
« la femme naît libre et demeure égale à l’homme en droits ».
Adressée à Marie-Antoinette, cette déclaration veut la convaincre de s’impliquer dans la lutte féministe.
Au moment de l’abolition de la royauté, en septembre 1792, Olympe de Gouges se rallie aux républicains les plus modérés. Elle estime que le couple royal ne mérite pas la mort, et se propose comme leur avocate. Ce qui lui sera refusé, au motif que seuls les hommes sont capables de plaider.
L’orage gronde chez les révolutionnaires. Dans les rangs de l’Assemblée nationale, deux camps luttent sans merci pour le pouvoir : les Girondins modérés et les Montagnards radicaux. Ce dernier groupe, mené par Robespierre, l’emporte. Sa politique consiste à arrêter et exécuter au plus vite un maximum d’opposants politiques.
Olympe de Gouges se sert de ses talents d’écrivaine pour dénoncer l’usage de la violence par le gouvernement de la Terreur. Certains de ses pamphlets, directement adressés à Robespierre, l’accusent de mettre en place un régime de dictature.
À la suite d’une insurrection parisienne en juin 1793, les Girondins sont en grande difficulté. Devant la Convention, Olympe prend publiquement la défense de ses membres. Le mois suivant, elle fait placarder dans tout Paris une affiche intitulée « Les trois urnes ou le salut de la Patrie ». Elle y suggère un référendum pour laisser aux Français le libre choix de leur gouvernement.
C’en est trop pour les Montagnards, qui l’accusent d’attenter à l’indivisibilité de la République. Arrêtée le 20 juillet, incarcérée dans la maison d’arrêt de l’Hôtel de Ville de Paris, elle sera détenue durant de longs mois dans des conditions inhumaines.
Olympe subit un procès expéditif le 2 novembre, suivi de son exécution le lendemain. Elle meurt guillotinée à 45 ans, place de la Concorde, en ayant proclamé jusqu’à la fin son opposition à la dictature.
Olympe de Gouges, une féministe avant l’heure
La naissance difficile du mouvement féministe au siècle des Lumières
Les philosophes des Lumières ont adopté des positions contrastées sur la place des femmes dans la société. La plupart étaient attachés à une distribution traditionnelle des rôles. Dans un même esprit conservateur, les révolutionnaires refusent d’intégrer les femmes dans la vie publique.
Elles ont pourtant joué un rôle actif dans la Révolution depuis le début. On les retrouve à l’initiative des grands rassemblements populaires pour protester contre la hausse des prix. Regroupées en assemblées féminines, elles diffusent des pétitions et des affiches informatives.
Après avoir toléré les clubs féministes durant quelque temps, une loi finit par les interdire à l’automne 1793. Et au fil des ans, les mesures se font de plus en plus contraignantes. On interdit aux femmes d’accéder aux tribunes de la Convention, puis d’assister aux assemblées politiques ou de s’attrouper. Certaines militantes sont pourchassées et arrêtées durant l’insurrection du 20 au 22 mai 1795.
Quelques mesures prises en faveur des femmes seront de courte durée. Le Code civil napoléonien de 1804 révoquera par exemple l’égalité des droits de succession, ou certaines avancées sur le plan de l’État civil. Le droit au divorce, tant réclamé par Olympe de Gouges, est instauré en 1792 pour être aboli vingt-quatre ans plus tard.
C’est dans ce contexte trouble qu’un mouvement féministe commence à se constituer. On y retrouve quelques personnalités en vue, telles que : Etta Palm d’Aelders, espionne et écrivaine, ou Anne-Josèphe Théroigne de Méricourt, engagée en politique.
Le féminisme essaime. Des écrivains et essayistes, toujours plus nombreux, se penchent sur le sujet :
- Marie-Armande Jeanne Gacon-Dufour, qui accuse les hommes d’avoir corrompu les femmes. Elle rédige un Mémoire pour le sexe féminin contre le sexe masculin, en 1787.
- Condorcet, qui demande en 1790 l’ouverture de la citoyenneté aux femmes dans son ouvrage : Sur l’admission des femmes au droit de cité.
- Mary Wollstonecraft, qui critique le patriarcat dans son pamphlet Défense des droits de la femme (A Vindication of the rights of women), paru en 1792.
Une militante infatigable des droits de la femme
S’appuyant sur ce frémissement intellectuel, Olympe de Gouges adopte une démarche originale. Elle plaide pour l’amélioration concrète de la vie des femmes les plus démunies.
Dans son texte En faveur des femmes, en avril 1789, elle rappelle que la pauvreté est la condition banale des femmes de son siècle. La faible instruction donnée aux filles les condamne à un état d’ignorance et de misère. Pour toutes celles qui n’ont pas eu la possibilité de se marier ou de trouver un protecteur fortuné, la vie devient un combat.
Attirant l’attention des députés sur le sort tragique des femmes malades, elle leur demande la création d’hôpitaux dédiés. En effet, dans les hôtels-Dieu déjà surchargés, les jeunes femmes qui accouchent sont mêlées aux prostituées et aux vagabonds. Elles meurent souvent dans de terribles souffrances, faute de soins adaptés.
En 1790, l’autrice évoque le sujet de la prise de voile forcée dans sa pièce Le Couvent. Devenir religieuse constituait en effet une solution pour toutes les jeunes filles dont la faible dot ne permettait pas l’accès au mariage.
Une autre de ses œuvres théâtrales, La nécessité du divorce, la place au rang des pionnières en faveur de ce droit. Plus tard, elle réclamera aussi l’abolition du mariage religieux, lui préférant une forme d’union civile réglementée.
L’écrivaine souhaitait que les femmes soient visibles en politique. Dans une formule restée célèbre, l’article 10 de sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne proclame :
« La femme a le droit de monter sur l’échafaud ; elle doit avoir également celui de monter à la tribune. »
D’après Olympe de Gouges, les femmes ne doivent pas tout attendre des hommes pour la mise en place d’une égalité des droits. Celles-ci devraient faire preuve d’audace pour prendre toute leur place dans la société. Aussi, dans ce même texte, elle les exhorte à sortir de leur passivité :
« Femme, réveille-toi, […] reconnais tes droits. […] Ô femmes ! Femmes, quand cesserez-vous vous d’être aveugles ? […] Quelles que soient les barrières que l’on vous oppose, il est en votre pouvoir de les affranchir ; vous n’avez qu’à le vouloir ».
La postérité d’Olympe la révolutionnaire
La censure des républicains, le mépris des historiens
Olympe a été éliminée pour avoir proclamé haut et fort ses opinions politiques dissidentes. Quelques jours après sa mort, la gazette La feuille du salut public, liée au pouvoir, trace un portrait d’elle virulent :
« Olympe de Gouges, née avec une imagination exaltée, prit son délire pour une inspiration de la Nature. Elle commença par déraisonner et finit par adopter le projet des perfidies qui voulaient diviser la France ; elle voulut être un homme d’État, et il semble que la loi ait puni cette conspiratrice d’avoir oublié les vertus qui conviennent à son sexe. » (Léopold Lacour, Trois femmes de la Révolution).
Au XIXe siècle, les grands historiens de la Révolution resteront très critiques vis-à-vis de la place de la femme en politique. Les rares figures de la cause féminine sont traitées d’insensées. Ne dérogeant pas à cette règle, Olympe de Gouges est qualifiée d’Occitane, d’illettrée et d’imprudente.
Une longue période d’oubli ou de censure commence. L’écrivaine est étrangement mise de côté : par les républicains, aux côtés desquels elle a pourtant combattu, et par les historiens. Elle illustre un moment dans lequel les femmes devaient demeurer silencieuses. N’accédant ni à la parole publique, ni à la publication.
Par son engagement contre l’esclavage et pour le droit des femmes, Olympe fait cependant partie intégrante du mouvement des Lumières. Celui qui se proposait de lutter contre tous les obscurantismes.
La réhabilitation tardive d’une pionnière
À la suite de sa fin tragique, de nombreuses femmes vont bénéficier d’une liberté d’expression nouvelle. Olympe a ouvert la voie à la génération suivante, celle de George Sand, Flora Tristan, et autres partisanes du mouvement saint-simonien.
L’autrice sort de l’oubli après la Seconde Guerre mondiale. Elle est d’abord étudiée aux États-Unis et en Allemagne comme une figure marquante de l’histoire révolutionnaire. Mais il faut attendre 1981 pour qu’une première biographie sérieuse soit proposée par Olivier Blanc.
Lors de son arrestation, les textes originaux d’Olympe de Gouges avaient été confisqués à son domicile. Exhumés des Archives nationales, ses écrits sont réédités, certaines de ses pièces enfin jouées !
La Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne reste son œuvre la plus emblématique. Elle est aujourd’hui reconnue comme l’un des textes fondateurs du féminisme moderne. Et de ce fait, son autrice est souvent présentée comme la première féministe française.
En 1989, son nom est pressenti pour entrer au Panthéon, sans que la procédure n’aboutisse. De nombreuses communes françaises lui ont aussi rendu hommage, en donnant son nom à des établissements scolaires, théâtres, rues.
Sa vie a fait l’objet de plusieurs biographies et a inspiré des écrivains contemporains. En 2012, un roman graphique de Catel et José-Louis Bocquet lui est consacré. Un biopic sorti en 2024, Olympe, une femme dans la Révolution, retrace sa vie tumultueuse, incarnée par Julie Gayet.
Révoltée, indocile, jusqu’au-boutiste, Olympe de Gouges est la femme de tous les superlatifs. Ses textes, vibrants d’audace, nous émeuvent, et son message a réussi à transcender les cultures et les époques. Dans un monde où les droits des femmes ne seront jamais vraiment acquis, Olympe de Gouges nous rappelle que leur pérennité nécessite un combat.
Femme, réveille-toi !
Sources :
https://memoire-esclavage.org/biographies/olympe-de-gouges
https://histoire-image.org/etudes/olympe-gouges?i=952
Olympe de Gouges, « Femme réveille-toi ! », Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne et autres écrits (préface Martine Reid), Paris, éditions Gallimard, 2014.
En attendant notre prochain article, n'oubliez pas de suivre notre podcast sur ces Femmes qui Osent