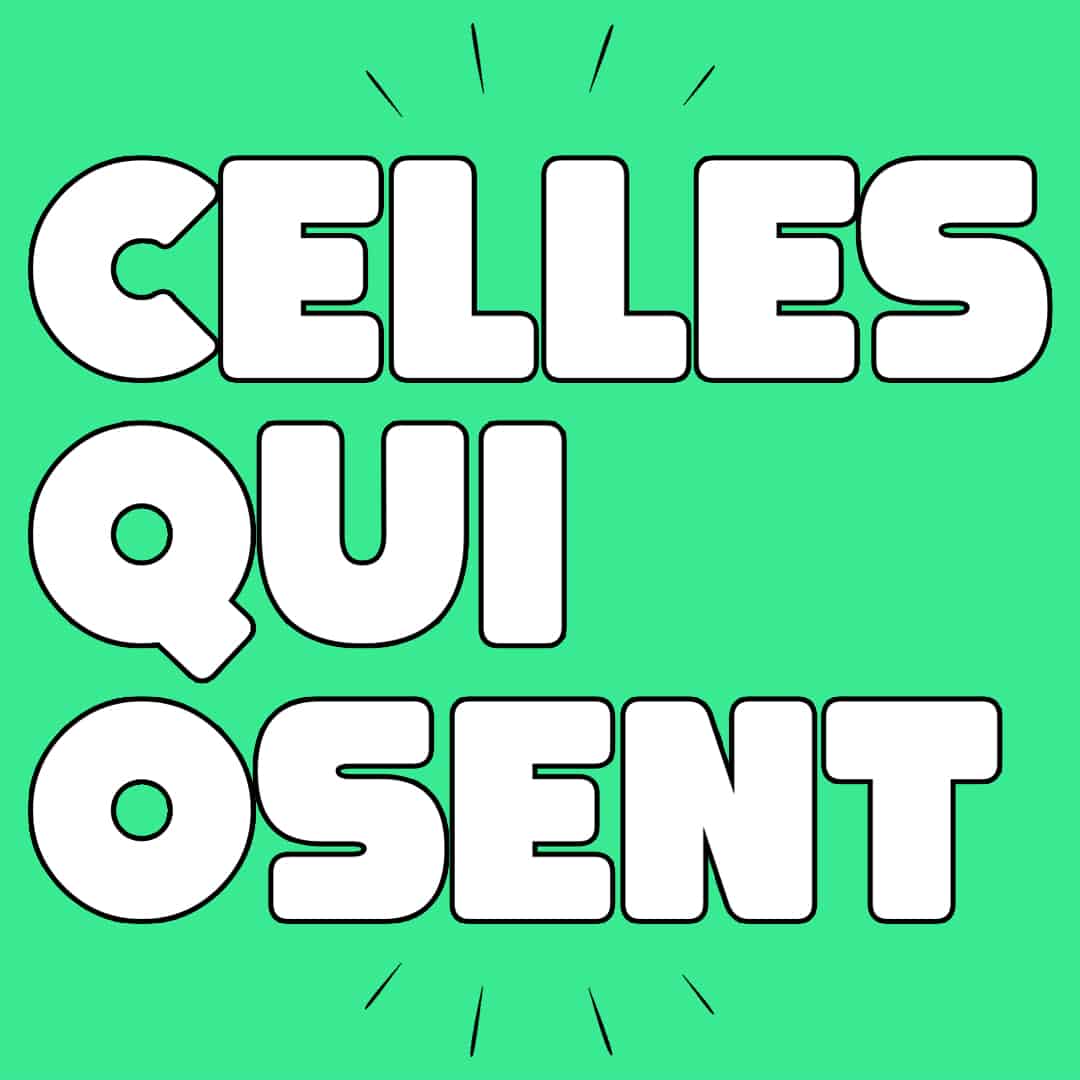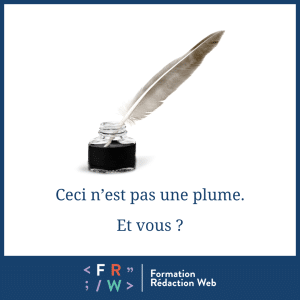Titiou Lecoq est journaliste, essayiste, romancière… et féministe. À travers son œuvre, on découvre un féminisme juste, drôle, documenté, combatif, mordant et littéraire. Une petite prouesse, il faut le dire. Que défend-elle ? Comment s’y prend-elle ?
Cet article propose une lecture croisée des ouvrages de Titiou Lecoq, afin de, modestement, promouvoir et soutenir son travail, sa pensée et son style.
Les idées développées ici sont principalement issues de ses trois livres suivants : Libérées !, Le couple et l’argent et Les grandes oubliées.
Libérées ! développe une théorie de la chaussette jusqu’à aboutir à un beau manifeste sur la place des femmes dans la société. Dans Le couple et l’argent, Titiou Lecoq narre l’histoire de Gwendoline, fictive et malheureusement réaliste, de son enfance à sa retraite, pour démontrer comment notre système fait de l’argent un facteur d’inégalités pour les femmes. Depuis la préhistoire jusqu’à nos jours, l’autrice refait l’Histoire dans Les grandes oubliées, en décortiquant et analysant, à chaque grand moment, quelle était la place des femmes, comment et pourquoi, tout en mettant à l’honneur nombre de femmes remarquables que l’Histoire a pourtant volontairement occultées ou oubliées. Elle raconte et documente les mécanismes qui ont abouti à l’invisibilisation des femmes. Elle dénonce beaucoup d’absurdités, qu’elles datent d’hier ou d’aujourd’hui, et rapporte nombre d’anecdotes et d’histoires de femmes ignorées des manuels.
Pour plus de clarté et lever toute ambiguïté avec de simples expressions guillemetées, il est précisé que les citations issues des ouvrages de Titiou Lecoq sont retranscrites dans cet article en italique et entre guillemets.
La bonne ménagère vue par Titiou Lecoq
Dans Libérées !, Titiou Lecoq prend le ménage comme fil conducteur, comme point de départ pour développer l’image de la « bonne ménagère » et tout ce qui lui incombe. Elle démarre avec un geste simple du quotidien pour l’amener progressivement vers des faits de société. Ainsi, la chaussette qui traîne devient métaphore : elle représente la charge mentale, d’abord celle liée à la chaussette et au ménage, et ensuite l’ensemble de la charge mentale pesant sur les femmes. De la même manière, on comprend au fil des pages, des constats et des réflexions que monsieur qui n’a pas le temps de ramasser cette fameuse chaussette métaphorise à lui tout seul la prérogative selon laquelle le temps des hommes est précieux (donc monétisé), pas celui des femmes.
Au travers des trois ouvrages, Titiou Lecoq parle de sacrifice à plusieurs reprises : la femme, c’est la personne qui se sacrifie. Elle doit donc donner gratuitement aux autres avant de se soucier d’elle-même. C’est la définition implicite, de longue date, qui est faite de la femme dans notre société. Ainsi, les métiers du soin, on le sait, sont très majoritairement féminins et peu rémunérés. En même temps, la société considère que c’est naturel chez les femmes, alors pourquoi les rétribuer pour un tel travail ? La problématique, très actuelle, des métiers du soin et plus généralement du genre du marché du travail, est abordée de façon approfondie et chiffrée.
Derrière la bonne ménagère se cachent aussi, indissociables, la bonne épouse et la bonne mère. Il est développé l’idée que les parents, et notamment les mères, ont trop d’injonctions, que les enfants esclavagisent ainsi malgré eux ces dernières. Titiou Lecoq démontre comment, combiné à tout le reste, les mères doivent gérer leur culpabilité, leur fatigue et effectuer des choix, choix que la société n’exige pas des hommes, qui, eux, peuvent « tout avoir ».
Historiquement, la bonne ménagère moderne naît après la Seconde Guerre mondiale. Les femmes obtiennent alors des droits importants, notamment le droit de vote. Mais, parallèlement, l’État se met à se soucier de la famille, sans se soucier des femmes. La politique de l’État est tournée vers la famille, comme le montre l’impôt actuel, mis en place en 1945 au détriment des droits des femmes (cf. plus loin). La femme devient la « bonne ménagère », uniquement considérée par le prisme de la conjugalité ou de la maternité. Il faut reconnaître que, de nos jours – oui, oui, en 2025 –, c’est encore le cas.
Les inégalités financières et l’impôt patriarcal
Les sources d’inégalités financières, en défaveur des femmes évidemment, sont nombreuses. Et surtout, on s’aperçoit en se penchant sur le sujet, qu’elles peuvent s’avérer fallacieuses car contre-intuitives ou peu connues. Avec grande pédagogie, Titiou Lecoq examine et documente les mécanismes financiers qui défavorisent les femmes tout au long de leur vie (remercions Gwendoline pour cette leçon de courage), et il faut souligner qu’ils sont liés au statut envieux de bonne ménagère, bonne épouse et bonne mère.
Dans Le couple et l’argent, elle explique comment l’inégalité financière démarre dès l’enfance, via l’argent de poche et plus largement le traitement éducatif prodigué par les parents selon le sexe de leur enfant. On apprend très tôt à un garçon à gérer son argent, à avoir une conscience financière, alors qu’on cède aux caprices d’une fille en lui achetant ce qu’elle réclame. Dès l’enfance, au travers de l’argent, on apprend aux garçons à gérer un budget et à gagner de l’argent. Aux filles, on apprend à dépenser (en bonne ménagère, bien sûr). On débourse autant pour l’un que pour l’autre, mais pas de la même manière, avec des impacts importants et très différents pour le reste de leur vie. D’ailleurs, la gestion de l’argent dans le couple n’est pas la même selon son niveau de richesse. Globalement, « les hommes gèrent la fortune [c’est le cas des couples riches] et les femmes la pauvreté [c’est le cas des couples pauvres] ». C’est finalement le reflet de cette éducation genrée. De façon analogue, je rajouterai que l’on peut souligner que l’on reproche souvent aux femmes de ne penser qu’à dépenser de l’argent, mais, dans ce cas, elles n’ont fait qu’intégrer ce qu’on leur a appris.
Après l’enfance et quelques épisodes, vient le couple. Dès son installation, il faut parler d’argent, car sans gestion commune, sans organisation du budget du couple, la situation profite financièrement au plus riche des deux, c’est-à-dire, en général, à l’homme. Statistiquement, le fait d’être en couple enrichit les hommes et appauvrit les femmes. Par exemple, la répartition des achats au sein du couple n’est pas anodine. Dépenser et acheter en fonction de chacun dans le couple, même équitablement, ne suffit pas. Il faut en effet considérer la nature des achats. Il y a des achats qui constituent un patrimoine (une voiture, des meubles), d’autres qui sont peu gratifiants (typiquement, les courses). Il faut équilibrer ces achats au sein du couple. Il est également expliqué comment l’homme se constitue, petit à petit, des économies avec son salaire, sous prétexte qu’il lui en reste une fois les dépenses communes effectuées, alors que le salaire de la femme passe intégralement dans les dépenses du ménage. Ou encore pourquoi le travail ménager devrait être un travail rémunéré, car gratuit, il contribue encore davantage à enrichir les hommes et à appauvrir les femmes.
De manière similaire, les enfants ne sont financièrement pas favorables aux femmes – c’est-à-dire aux mères – et provoquent même une augmentation de salaire chez les pères. Les causes sont multiples : le temps partiel, l’acceptation d’un boulot moins bien payé mais plus pratique, les discriminations au travail.
Titiou Lecoq détaille également les mécanismes qui, lors d’une séparation, aboutissent à un appauvrissement féminin, et qui sont en partie la résultante de tous les mécanismes inconscients et invisibles précédemment mentionnés. L’héritage et la retraite posent également problème. Les femmes s’occupent en majorité des parents âgés (voir paragraphe précédent sur le don de soi) et héritent moins que leurs frères. Quant à la retraite, c’est le summum des inégalités subies tout au long de la vie : tout est cumulé pour en faire un cocktail explosif de pauvreté pour les retraitées.
L’autrice insiste sur le fait qu’il faut passer outre l’aspect peu romantique de l’argent dans le couple, car le jeu en vaut la chandelle pour réduire les inégalités et les mauvaises surprises. Selon elle, de nombreux écueils pourraient être évités.
Elle évoque également la taxe rose, que tout un chacun peut constater en magasin et qui regroupe en résumé deux phénomènes : d’une part, le trop grand nombre d’injonctions à la beauté, qui engendre des dépenses pour les femmes ; d’autre part, le fait que les produits féminins sont souvent plus chers que leurs équivalents masculins, voire chers tout court lorsqu’ils n’ont pas d’équivalent.
Enfin, et le sujet n’est pas des moindres, Titiou Lecoq décortique dans un chapitre sur l’impôt particulièrement édifiant comment le système de l’impôt sur le revenu en France n’est rien de moins qu’une grosse arnaque patriarcale, et pas seulement vis-à-vis des femmes, mais vis-à-vis de toute la société. En effet, le système actuel, qui date donc de 1945, favorise les hommes mariés et riches au détriment de toutes les autres personnes. Ce chapitre portant sur un sujet relativement peu connu est très intéressant, bien expliqué et documenté, avec des solutions mises en avant.
La théorie des deux sphères expliquée par Titiou Lecoq
C’est au XIXᵉ siècle que naît, en tant que telle, la théorie des deux sphères, qui perdure encore aujourd’hui. Elle se résume au postulat très simple suivant : les hommes dehors, les femmes dedans.
Le Moyen Âge est une période où les femmes ont eu une grande influence, même dans une société patriarcale. Titiou Lecoq explique que cette société médiévale est cependant moins patriarcale que régie par une hiérarchie de classes : le clergé, les nobles, les paysans (et les autres). Une telle organisation permet ainsi à certaines femmes d’exercer de véritables fonctions de pouvoir, ou au moins de faire jouer ce qu’on appellerait aujourd’hui le « réseau ». Au Moyen Âge, les femmes sont ainsi présentes dans toute la société, dans tous les métiers, et ne sont pas cantonnées au travail domestique.
Les choses commencent à se gâter pour elles au XIIIᵉ siècle, notamment à cause des clercs qui passent à l’offensive. Ils sont profondément misogynes, et comme savoir et pouvoir vont de pair, ils écartent les femmes du savoir, notamment des universités, pour qu’elles n’accèdent pas au pouvoir. De la fin du Moyen Âge jusqu’à la Renaissance, les conditions des femmes se dégradent en même temps qu’elles sont progressivement renvoyées à la maison. On apprend notamment que la Renaissance, contrairement à ce que l’on enseigne à l’école, n’est pas une période magique qui porte bien son nom, car elle a été désastreuse pour les femmes.
Au XIXe siècle, aidées par Napoléon Bonaparte et son Code civil, les femmes sont violemment exclues de la société et perdent leurs droits, notamment les droits liés à l’argent. On commence à théoriser qu’à l’image de leurs organes sexuels respectifs, les femmes doivent se cantonner au dedans, c’est-à-dire au domestique (ce qui en fait un joli prétexte pour servir les hommes), et les hommes ont toute leur place dehors, dans le monde extérieur. C’est par ailleurs à ce moment-là que l’on perd la mémoire de la place des femmes dans l’Histoire, jusqu’à les effacer complètement. Et cela ne fait que renforcer l’idée que les femmes sont des bonnes ménagères depuis toujours.
Par cette théorie des deux sphères, la femme est privée de liberté, car elle n’accède pas au monde, c’est-à-dire au monde extérieur. Il ne faut pas croire que ces idées sont dépassées ou ne sont plus d’actualité, car les mêmes ressorts et les mêmes raisonnements sont encore à l’œuvre de nos jours. Même si aujourd’hui, la femme peut travailler, sortir, occuper l’espace public, force est de constater que la femme reste tout de même renvoyée et associée au domestique et que l’espace public constitue encore un danger pour elle.
Ce danger est intelligemment représenté par le sac à main, dans un chapitre qui lui est dédié. À l’instar de la chaussette, Titiou Lecoq part d’un objet anodin pour mettre au jour un fait de société accablant. Ce sac à main, évidemment uniquement féminin, c’est un « au cas où ». Cette fonction représente toute la charge mentale de l’anticipation. Anticipation pour la femme elle-même, contre l’extérieur et ses dangers, et anticipation pour les autres, en cas de besoin. À travers ce chapitre, à la fois très drôle et très éclairant, elle explique que le sac à main reste le symbole de l’hostilité du monde extérieur envers les femmes.
On apprend également comment, notamment en ville, l’espace public est développé et agencé pour les hommes. Et cela démarre tôt, avec les espaces de loisirs davantage tournés vers les jeunes garçons que vers les jeunes filles (il n’y a qu’à voir les cours de récréation dès la maternelle et la primaire, même si ce constat n’est pas mentionné dans les ouvrages).
Paradoxalement, ce sont les hommes qui sont source de problème dans l’espace public. Une certaine logique voudrait que ce soit donc eux qui restent à la maison. Titiou Lecoq propose d’inverser la logique des deux sphères (ironiquement ou sérieusement ? à vous de choisir) : puisque que les hommes sont source de danger et puisque leurs organes sont bien trop fragiles pour affronter l’extérieur, laissons les hommes dedans et sortons !
La solution de privatiser une partie de l’espace pour les femmes (par exemple des wagons de métro qui leur sont dédiés) n’en est pas une, car elle renforce un cercle vicieux. Il faut que la femme ait sa place, et c’est à l’homme de la lui laisser, en faisant en sorte que l’extérieur ne soit plus un danger du fait de son propre comportement d’homme. Il faut que la femme se réapproprie l’extérieur en arrêtant de se sentir victime et incapable. Cela va de pair avec le droit de regard que s’arroge la société, c’est-à-dire les hommes, sur les femmes. Elles sont constamment jugées et privées de leur parole et de leur réflexion. La société sait mieux ce qui est bien pour elles-mêmes, comment elles doivent être et comment elles doivent agir.
Liés à la théorie des deux sphères, Titiou Lecoq expose l’impact négatif des réseaux sociaux et développe la notion d’« AirSpace ». Les réseaux sociaux valorisent la bonne ménagère en affichant des intérieurs et des styles de vie complètement idéalisés. Bien sûr, ce sont des femmes qui se montrent ainsi, ramenant encore l’ensemble de la gent féminine à la maison, pour un idéal qui n’est ni réaliste ni enviable. De manière analogue, l’AirSpace est une idée assez dystopique conduisant les robots que nous sommes à vouloir homogénéiser tous les lieux en dehors de chez soi, par exemple les cafés, pour s’y sentir comme à la maison. Titiou Lecoq écrit par exemple : « Mais en réalité, quand on est dans l’AirSpace, on n’est pas chez soi. » Phrase effrayante, non ? Cette homogénéité itérée partout, à l’intérieur ou à l’extérieur, présente un aspect paradoxal, car elle a quelque chose de très réconfortant et esthétique, mais s’avère très nocive. Tout est lissé, rien d’autre que leur idéal n’est possible. Ces mensonges nous amènent à une perte du réel problématique, et « la seule chose réelle que ces photos expriment, c’est la réassignation des femmes au domestique », conclut Titiou Lecoq.
Selon Titiou Lecoq, savoir, c’est pouvoir
Au travers de ses œuvres, l’autrice met en lumière comment et pourquoi la mémoire et le savoir sont des éléments vitaux pour défendre la place des femmes, à plusieurs égards.
Avec Les grandes oubliées, elle produit un travail mémoriel considérable, qui doit nous inciter à collectivement se réapproprier notre Histoire dans son intégralité. Il s’agit d’une part de ne pas avoir de vision fausse de notre passé – les femmes ont existé et ont même brillé –, il s’agit pour les petites filles d’avoir des modèles, et il s’agit de ne pas recommencer le combat féministe inlassablement. Comme elle l’explique pertinemment, celui-ci se répète régulièrement au cours de l’Histoire, avec les mêmes constats et les mêmes revendications. Chaque génération doit tout réinventer, car on a oublié ce qui a été fait, qui avait milité et comment. À l’issue de la lecture de cet ouvrage, mon constat est simple : brûlons les manuels scolaires d’histoire ! Pour une fois, on peut dire qu’il faut réécrire l’Histoire, la réécrire pour enseigner une Histoire plus vraie et plus juste, dans laquelle les femmes ne sont pas oubliées.
Avec les progrès de la science lors du siècle des Lumières – pas si lumineuses –, on améliore nos connaissances en biologie et, alors, ce devient scientifiquement prouvé : la femme est inférieure. C’est scientifique, biologique, naturel. Bref, les gens pensent que c’est vrai. Avec ces mêmes arguments, se développe également le racisme et, avec lui, l’esclavage. Titiou Lecoq éclaire bien comment les mêmes mécanismes et raisonnements servent à mettre les gens dans des cases en fonction de leur sexe ou de leur couleur de peau. Inutile de dire que la seule case qui brille est celle de l’homme blanc. Moi qui me suis toujours considérée comme une scientifique, ce passage m’a heurtée : la science avait fait des dégâts. Heureusement, Titiou Lecoq explique juste après que tout cela n’était pas de la vraie science, seulement des arguments factices et politiques. La science a l’honneur sauf. Ici, on voit comment, a contrario, le (faux) savoir a servi à justifier la place des femmes.
Parce que, justement, savoir, c’est pouvoir, l’une des revendications principales des femmes du XIXᵉ siècle est l’instruction. Et pour une fois, elles vont réussir. Parallèlement se développent également des mouvements sociaux, au sein desquels les femmes font du « social », un social qui s’avère très politique. À l’instar d’Henriette Brunhes avec la Ligue sociale d’acheteurs, et que je suis obligée de citer : c’est mon aïeule directe et Titiou Lecoq la mentionne comme pionnière de la mode éthique et responsable. Quelle émotion en lisant ce passage !
Savoir, c’est aussi de nos jours avoir une éducation financière. Titiou Lecoq insiste là-dessus. Si les femmes avaient une réelle éducation financière, si elles savaient comment l’argent fonctionne et se gère, elles pourraient réduire les effets des inégalités financières à leur encontre.
Le style Titiou Lecoq
Selon l’autrice, le féminisme passe par la parole. La femme doit parler pour défendre sa cause et gagner sa place dans le monde, malgré les difficultés à le faire et malgré les paradoxes (les statistiques sont claires, les femmes sont en majorité plus diplômées… et plus modestes).
Titiou Lecoq, elle, prend la parole en écrivant, en écrivant bien et juste. Avec une parole tout à la fois littéraire, crue, drôle, sérieuse, cultivée, pédagogique, engagée. Certains diront que son style d’écriture est vulgaire, mais ce sont sans doute les mêmes qui pensent que la place des femmes est à la maison. Alors…
« Et que, conséquemment, les corvées, c’est pour ma gueule. »
Phrase magnifique. Le vulgaire est parfois nécessaire, il est percutant, il est parlant, sans détour. Du reste, l’autrice écrit aussi de très beaux passages, à la fois sur le fond et sur la forme.
Son style d’écriture dépoussière les idées et rend la lecture de ses ouvrages d’une facilité déconcertante. Sa biographie de Balzac, Honoré et moi, est en ce sens une merveille. De même que son passage sur Brunehaut (pourquoi en est-on arrivé à oublier une telle reine, aussi importante par sa vie rocambolesque que par son rôle influent dans l’Histoire de France ?). Le récit qu’elle fait de sa vie, tellement drôle, dénote un sens de la narration que l’on voudrait voir plus souvent ailleurs.
Le style Titiou Lecoq, c’est également l’immense travail de recherches qu’elle effectue pour asseoir son propos. Elle se montre très humble là-dessus, mais tout ce qu’elle raconte, l’Histoire, les anecdotes, les chiffres, les statistiques, les études sociologiques, Balzac, les livres divers et variés, de Simone de Beauvoir à Michelle Perrot, tout démontre les recherches précieuses et considérables qu’elle a menées pour nous.
Et elle ne se contente pas de raconter et d’énumérer. Elle croise, analyse, alerte, elle prend position et propose des solutions. Le féminisme de Titiou Lecoq, c’est tout cela à la fois.
Elle a une phrase assassine que j’admire :
« Le yoga, la sophrologie ou l’aromathérapie vous apaisent peut-être à gérer cette tension permanente, mais ça ne vous empêche pas d’essayer aussi le féminisme. »
Cette phrase en dit beaucoup, à la fois sur le fait que beaucoup de femmes se trompent, ne font ainsi pas avancer la cause et même la dévoient, et à la fois sur le fait que le féminisme est bien un combat (c’est d’ailleurs le sous-titre de l’ouvrage). Le féminisme est une lutte, pas un cours de yoga.
Au travers de ses écrits, de son humour, de ses punchlines, de ses innombrables recherches, de son intelligence et de son amour pour Balzac, Titiou Lecoq est une combattante, une vraie. Suivons-la sans réserve.
Sonia Corvi
Bibliographie
Les ouvrages suivants de Titiou Lecoq :
Les Morues (2011)
Chroniques de la débrouille (2015)
Libérées ! Le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale (2017)
Honoré et moi (2019)
Les grandes oubliées, Pourquoi l’Histoire a effacé les femmes (2021)
Le couple et l’argent, Pourquoi les hommes sont plus riches que les femmes (2022)