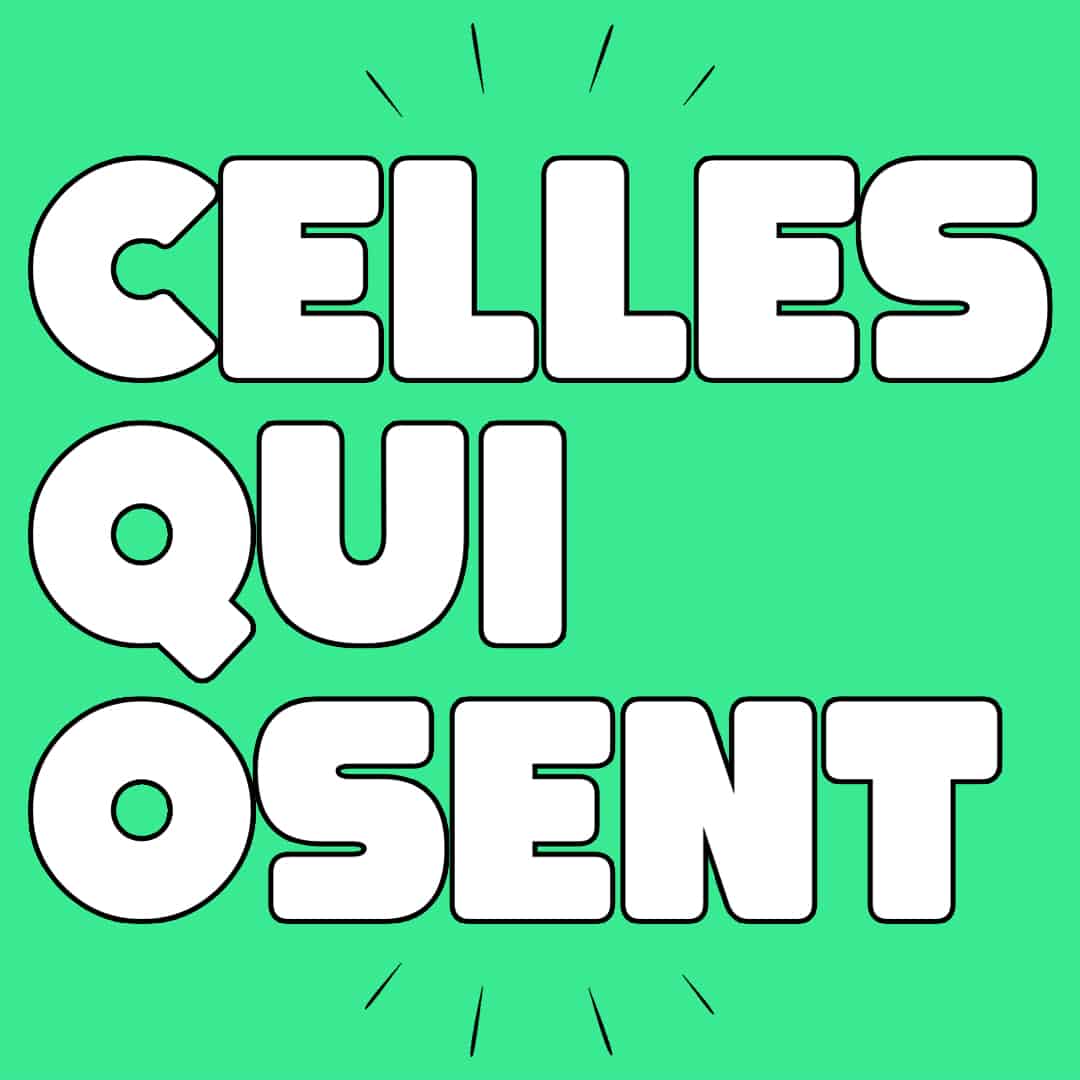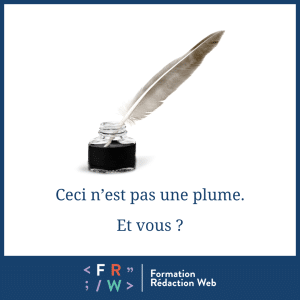Entretien avec Titiou Lecoq
Entretien réalisé le 02 mai 2025 autour de deux cafés au lait. Il s’agit ici d’une retranscription fidèle de cet échange ; seules certaines oralités ont été quelque peu gommées afin d’en faciliter la lecture.
Concrètement, aujourd’hui, comment faut-il lutter, selon vous, dans le combat féministe ? Est-ce qu’il faut continuer à documenter comme vous le faites ? devenir radicale ? laisser faire nos politiques ? …
Depuis très longtemps, je pense qu’il n’y a pas une bonne méthode ; être très radicale en remettant en cause tout le système ou demander quelque chose de plus social-démocrate, réformiste, de monter telle réforme, etc. En fait, il faut les deux. Typiquement, quand on obtient une réforme d’un gouvernement, c’est aussi parce qu’il y a une frange plus radicale qui est là pour pousser derrière. Les différentes formes de militantisme se nourrissent les unes les autres, et c’est comme ça que ça avance. Ensuite, toi individuellement, tu te dis « moi je me sens plutôt à l’aise là » ou « je pense que je suis plutôt utile ici ». Souvent, on me demande s’il y a des choses trop radicales, mais non, en fait, elles servent. Elles nous servent vraiment, elles maintiennent un niveau de pression et de conscience dans la société qui est hyper important. Personnellement, là où je vais être meilleure, c’est dans le fait d’aller faire des recherches, de documenter, de synthétiser les choses, d’essayer de réfléchir sur certains sujets, très pragmatiques. Je pars toujours de la vie quotidienne. Ma place, je l’ai trouvée ainsi. Mais je sais qu’elle fonctionne parce qu’il y a les autres autour.
Parmi les grands sujets que je trouve importants : cela fait plusieurs fois que, autour de moi, on se pose la question d’accepter des invitations à des évènements où il y a des gens problématiques. Vu comme le vent a tourné, j’ai plutôt tendance à dire qu’on y va. Parce que, eux, ils seront toujours invités. Tandis que notre espace médiatique diminue. On ne peut pas se permettre de ne pas y aller ; il faut être là et exister, tenir les positions.
En ce moment, et j’écris dessus pour mon prochain livre, j’ai envie d’aller parler aux jeunes hommes. Avec l’élection de Trump et des masculinistes, cela fait longtemps que je les étudie. Je travaille dessus parce qu’avec internet, je les ai vus monter, vraiment, au fur et à mesure. Et au départ, c’était rigolo. Quand je voyais certaines choses, je me disais que c’était du second degré. Mais dix ans plus tard, non, pas du tout ! Je les ai vus monter en pression. Avec mes enfants, des garçons qui vont sur internet, je me suis rendu compte que l’algorithme fait en sorte que ce sont les masculinistes qui leur parlent, et non les féministes. Les féministes ne parlent pas aux garçons de 15 ans que je peux croiser. Donc je me dis qu’il faut aller parler aux jeunes hommes ; on ne l’a pas encore fait, on ne s’est pas adressé à eux. Et on va avoir besoin d’eux aussi.
Justement, cela fait partie de mes prochaines questions. Têtard et Curly, si j’ai bien calculé, ont 13 et bientôt 11 ans.
Oui, bravo, c’est ça, tout à fait !
J’ai fait mes petits calculs, car il y a plein de choses dans vos livres, n’est-ce pas ?
Oui, et puis tu as travaillé dans le renseignement, alors après, c’est facile de retracer.
Et donc question un peu bateau. Je n’aime pas les questions bateau, mais est-ce qu’ils ont conscience de tout ce que vous faites, de vos idées, et est-ce que vous arrivez, à votre échelle, à leur inculquer des choses, justement, là-dessus ? Ou est-ce compliqué, notamment la vie perso qui prend le dessus ?
Non, non, hyper intéressant comme question ! Ils sont conscients de ce je fais, et en même temps, je me suis toujours dis que je ne veux pas les saouler avec ça, pour ne pas les braquer. Genre tu es de gauche et tu élèves un enfant de droite. Enfin, tu vois. Donc j’ai toujours fait attention, mais malgré tout, le sujet les intéresse. Ils me posent des questions, je vois qu’ils ont des réflexions. L’autre jour, Têtard, dans sa chambre, a retrouvé un début de roman qu’il avait écrit quand il avait 9 ans. Et c’est à la première personne. C’était l’histoire d’une héroïne. Il avait écrit un « je » féminin, et il m’a dit « franchement, maman, t’as vu ? ». C’est dingue ! Et en même temps, ils sont fans de foot. Enfin, ils cochent toutes les cases de la masculinité. Mais ils ont vraiment les outils, ils s’en rendent compte. Je ne les saoule pas du tout avec ça. J’en parle beaucoup parce que je suis en train de finir le livre que je publie en septembre, mais, un enfant, ce n’est pas un projet politique.
J’ai des copines qui ont des filles et qui disent « Ah mais elles adorent les princesses, c’est terrible, tout est foutu ». Je jouais à la Barbie, et ça ne m’a pas empêché de lire Simone de Beauvoir. Il faut dédramatiser !
Récemment, Têtard n’avait plus rien à lire et s’est dit qu’il allait lire mon livre, Une époque en or. J’étais là « mais non ! ». C’est assez rigolo, il est en train de le lire. Je pensais qu’il aurait un rejet complet. Ils sont plutôt très fiers. Curly, ça ne l’intéresse pas plus que ça, mais si on me reconnaît dans la rue, vraiment, cela fait sa journée, il en est très heureux.
En plus, à la maison, on n’est pas du tout à 50/50 sur les tâches ménagères par exemple. C’est très clair, et je leur dis que je fais beaucoup plus et que je m’occupe majoritairement d’eux. Ils en ont assez conscience. Du coup, je pense qu’ils savent lire les inégalités et les décrypter, pourquoi cela se met en place. Cependant, ils n’ont pas un modèle égalitaire pour autant sous les yeux.
Alors autre question. J’ai eu du mal à trouver un exemple pour faire comprendre ce que je voulais dire. Donc partons du constat suivant : on imagine un homme et une femme en entreprise. L’homme va avoir une belle augmentation et souvent, on va le glorifier, on va dire de lui « Ah c’est chouette, il a osé et il a obtenu ce qu’il voulait ». La femme, elle n’a rien demandé – c’est un peu cliché ce que je dis, mais c’est quand même assez vrai – et elle n’a rien eu, ou même elle a demandé, elle n’a rien eu ou très peu. Et si elle s’en plaint, on va sans doute penser qu’elle est trop modeste, ou tout simplement, qu’elle n’avait qu’à demander. Mais est-ce qu’il ne faut pas renverser la pensée ? En partant de cet exemple, peut-on généraliser ? Souvent, on va chercher à aligner les femmes sur les hommes, car on fait toujours la démarche d’ériger l’homme comme modèle. Alors que, des fois, n’est-ce pas eux qui ont tort dans leur comportement ? N’est-ce pas eux qui ont finalement trop de libertés ? Je ne sais pas si je suis claire, j’ai du mal à formuler cette question que je trouve rarement abordée.
Oui, oui, tout à fait. Il y a une explication historique au fait, qu’au départ, les féministes du 19e se sont organisées pour demander les mêmes droits que les hommes, le droit de vote, le droit d’être élue. Et après ? Effectivement, on est restés sur cette ligne-là, en partie parce que le masculin est plus valorisé. Mais je pense que cela est en train de bouger un peu dans la société, et beaucoup dans les milieux féministes. Cependant, c’est vrai que ce n’est jamais abordé, pour l’instant, d’un point de vue institutionnel. Vraiment, le discours étatique sur l’égalité est d’aligner les femmes sur les hommes. Donc je suis d’accord.
Ce que je dis souvent aux élèves, justement, c’est que les garçons ont à gagner avec le féminisme. Ce sont les féministes qui sont dans la rue pour se battre pour le congé paternité, pas les masculinistes. Tu vois, l’allongement du congé paternité, waouh, c’était la première fois qu’on demandait à s’aligner sur les femmes. Je voudrais que ce soit évidemment la même durée et qu’il soit obligatoire mais cela commence à rentrer dans le débat public. Avec cet angle-là, il faut réinvestir les hommes sur la famille, les enfants, les émotions, etc. C’est vraiment le discours anti-masculiniste. Un masculiniste, c’est quand même un sociopathe qui n’a pas d’émotion. C’est ça, un vrai mec, quand même.
À un moment, j’avais dit : si c’est tellement compliqué d’aligner les salaires des femmes sur ceux des hommes, si ça coûte trop cher, alignons ceux des hommes sur ceux des femmes ; on n’a qu’à baisser les salaires des hommes. Et là, on verra s’ils sont motivés. Je me disais vraiment, vas-y, on fait l’égalité par le bas si vous voulez. On n’a qu’à baisser tous les salaires des hommes de 4 %, les 4 % d’on-sait-quoi d’écart de salaire.
Mona Chollet parle également du fait que les femmes se comportent mieux dans le milieu du travail. Et j’avais rencontré une sociologue spécialisée sur les questions de genre à l’université, en France. Elle déménageait en Suisse et elle s’est dit qu’elle voulait promouvoir l’égalité. Comment faire concrètement ? À part juste parler à des étudiants ? Elle a monté une boîte de recrutement pour aider les entreprises à faire des recrutements plus égalitaires et moins discriminatoires. Et notamment sur les questions de management, elle m’a dit qu’en entretien d’embauche, le candidat qui répond un peu trop bien, ose trop, sera un manager toxique. Car ce sont tous les red flags. Sauf que ces red flags sont considérés comme positifs dans le monde de l’entreprise. Donc elle travaille vraiment là-dessus : expliquer cela aux entreprises, ce à quoi il faut faire attention, que pour gérer des équipes, il ne faut pas être trop sûr de soi, affirmer trop son point de vue. C’est aussi en lien avec un autre problème d’inégalité. Maintenant, les filles sont plus diplômées que les garçons, mais les qualités qui sont valorisées dans le milieu scolaire ne sont pas celles qui seront valorisées dans le monde du travail. Et les garçons ont toujours une prime parce qu’ils arrivent, effectivement, à être ceux qui prennent la parole, qui coupent la parole, et c’est valorisé dans le monde du travail, alors que ça ne l’est pas à l’école.
Du coup, on a un peu abordé ma question suivante, qui est liée à cette idée de liberté. On part souvent du constat que les femmes ont plein d’injonctions, de toutes sortes, et tu en parles très bien, notamment dans Libérées !. Cependant, le modèle de l’homme viril est aussi une forme d’injonction pour eux. Alors ne faut-il pas aussi écrire un Libérés ! au masculin ? Car si on déconstruit ce modèle de l’homme viril, n’aura-t-on pas à terme une société plus égalitaire ?
Oui, ce serait une bonne idée. Un de mes fils m’avait dit « Oh, tu ne pourrais pas faire pareil mais pour les hommes ? » C’est pour cela que j’évoquais le fait d’aller parler aux garçons. Je pense vraiment qu’il s’agit de la question de la masculinité toxique. Ce que je fais avec les élèves en lycée, c’est de lister ce qu’on demande à un « vrai mec » ; après on essaie de voir en quoi c’est négatif. Je leur parle de santé mentale, du taux de suicide chez les hommes, du milieu carcéral. Ce dernier est lié au besoin de gagner de l’argent, de rapporter de l’argent, etc. C’est le fait de faire du trafic de stups et de se retrouver incarcéré. Le fait que la prudence soit perçue comme une qualité féminine implique qu’il ne faut pas être prudent, donc être dans la prise de risque (les accidents de la route, par exemple) ; cette prise de risque est très valorisée. Donc je suis d’accord avec toi, il y a plein de choses là-dessus, effectivement, à déconstruire.
Mais vous trouvez qu’on en parle assez ou pas trop justement ?
Moi, j’ai un biais, parce que je m’y intéresse depuis quelques mois. Donc j’ai du mal à m’en rendre compte. Avec la série Adolescence, c’est comme si les gens avaient découvert les masculinistes. Sérieux ? Donc effectivement, peut-être qu’on n’en parle pas, que ce n’est pas passé du côté du grand public.
Je pense qu’il y a deux sujets liés à cela, notamment une question de génération. Ceux de ma génération qui ont eu des garçons et qui se sont posé ces questions-là, au départ, c’étaient des petits garçons, donc on était sur « tu peux pleurer », « tu peux jouer à la poupée ». On était très axés sur la question de comment élever un petit garçon, et pas sur celle d’élever un homme, qu’on n’avait pas encore. Et donc moi, le fait que je m’intéresse aux ados, c’est évidemment parce que mes enfants grandissent. C’est lié à une certaine temporalité. Donc je pense qu’il y a un lien comme ça, un peu générationnel, qui fait qu’on ne s’est pas emparé complètement de ce sujet-là.
Et l’autre sujet, c’est la question de savoir si c’est à nous de le faire ou aux hommes. Dans ce que j’ai écrit, notamment pour les jeunes hommes, je dis qu’on va avoir besoin de rôle modèle masculin positif. À un moment, faites votre part aussi ! Pour l’instant, on ne les a pas trop vus, ces modèles.
Dernière question sur la partie purement féminisme : vous, actuellement, que continuez-vous à faire ?
Le prochain livre, en septembre, tourne quand même beaucoup autour de deux sujets : comment garder espoir dans les circonstances actuelles et des questions autour des hommes et des garçons, que fait-on d’eux dans le féminisme. Donc je continue à réfléchir là-dessus. Après, un peu plus concrètement, je peux intervenir dans des entreprises sur l’égalité financière, et refaire la même intervention le lendemain auprès de femmes migrantes de Montreuil, comme je l’ai fait récemment. J’essaie de parler à des publics différents et parler à des femmes migrantes, c’était hyper enrichissant ; parler à des gens dans les entreprises, un univers que je ne connais pas, c’est aussi hyper enrichissant. J’essaie aussi d’aller parler aux lycéens à Saint-Denis. Tous les ans, je me dis stop, j’arrête, c’est épuisant ; mais c’est important. La dernière intervention que j’ai faite, c’était en prison. J’ai parlé à des détenus. Et c’est compliqué d’aller parler à des gens qui sont sans doute condamnés pour féminicide ou pour viol. Et en même temps, je me suis dit que c’est là aussi qu’il faut venir parler. Il faut occuper les positions.
Après le féminisme, deuxième sujet que je voulais aborder avec toi : tout ce qui touche à l’écologie, la crise climatique, la biodiversité, etc. Vous n’avez pas encore écrit là-dessus, est-ce que vous avez prévu de le faire ? Et comment vis-tu la crise climatique ?
Alors je pense que j’ai écrit dessus quand je faisais la newsletter de Slate, j’écrivais toutes les semaines. J’ai commencé à écrire dessus, à écrire de plus en plus. Cela me paraissait être le sujet prioritaire, avec le féminisme. J’avais donc commencé à écrire sur ce sujet, mais sous forme d’articles, et tout en me disant que je n’étais pas spécialiste du domaine. Il y aurait eu beaucoup à dire. Je n’écris pas de livre dessus ; en revanche, tu verras, dans mon roman Une époque en or, j’en parle, mais pas sous l’angle politique. Je parle de l’expérience existentielle actuelle, plus que de l’écoanxiété. C’est se dire qu’a priori, demain ne sera pas mieux qu’aujourd’hui, surtout quand tu as des enfants. C’est quand même très compliqué. Il faut être transparente, dire la vérité aux enfants ; je leur mens, je ne peux pas leur dire que le GIEC a dit que… Ce n’est pas possible, tu ne peux pas leur dire ça. Donc tu es obligée d’édulcorer, de leur dire « mais oui, bien sûr, tu as éteint le robinet pour te laver les dents, les ours te remercient, mon petit chéri d’amour ». Il y a aussi cette impression que l’on va vers une fin du monde et qu’en même temps, tout continue comme d’habitude. C’est-à-dire qu’on se dit qu’on va tellement en baver dans 20 ans, et alors, cet été, vous allez où ? Vous retournez en Grèce, ou pas ? C’est quelque chose que je vis, et je me dis « waouh », d’un point de vue cognitif, c’est quand même très impressionnant. Cela m’intéressait dans le roman d’en parler du point de vue de quelqu’un qui n’a pas de rôle politique, qui n’a pas de pouvoir politique, qui se demande juste comment on deale avec ça au quotidien. Je pense que c’est vraiment existentiel. C’est un rapport au monde et à la vie. Tu te demandes comment te placer par rapport à ça, et quel est l’effet d’être d’une génération qui a connu avant, avec un peu l’idée d’un monde sans fin. Et dans Une époque en or, l’héroïne dit – ce qui en fait est repris d’un article que j’avais écrit, j’étais à fond là-dessus – qu’elle voudrait un Churchill de l’écologie ; elle voudrait qu’il y ait quelqu’un au pouvoir qui dise « OK, ça va être hyper dur, on va en baver, on va modifier le système », et il va y avoir du sang et des larmes. Quelque part, il faut qu’on nous impose les choses : interdiction de la vente de cigarettes, interdiction d’aller en Grèce, etc. Sinon, on est dans le compromis : j’ai le droit parce que j’ai un compost à la maison. Et je pense qu’en plus, les gens attendent ça ; une partie en tout cas. On n’a plus trop le choix.
Faut-il lier écologie et féminisme ? Faut-il les hiérarchiser ? Ou est-ce que ce sont deux combats complètement différents ? Est-ce qu’il y a des ressorts communs ?
Il y a évidemment des liens entre ces deux sujets, parce qu’ils sont basés sur des rapports de domination. Il y a un peu cette idée de se dire que si on commence à prendre des mesures écolo, cela signifie modifier le système économique et donc si possible modifier le système social. On pourrait arriver ainsi à avancer sur les égalités femmes-hommes. Mais je ne sais pas si d’un point de vue politique, c’est le plus vendeur. Moi, je suis pour, alors allons-y, mais je ne suis pas certaine que cela marche auprès de la majorité des gens. Et j’ai remarqué autre chose, en travaillant avec les jeunes, c’est que le mot « féminisme », je le trouve super, mais il crispe plein de gens. Si tu leur parles d’égalité, ils adhèrent, si tu leur parles de féminisme, non. Déjà que l’écologie crispe du monde, si tu mets « écoféminisme »… Tu ne gagnes pas une élection en parlant d’écoféminisme. On peut donc avancer sur ces idées sans mettre forcément le terme d’écoféminisme. En plus, il fait un peu écoterrorisme…
Pour l’écologie, on parle beaucoup de « greenwashing », y a-t-il l’équivalent pour le féminisme ? Quel terme emploies-tu pour cela ? « Greenwashing » est à prendre au sens large, toute la communication trompeuse des entreprises et des institutions mais aussi ce que nous faisons chacun comme gestes au quotidien en pensant bien faire.
L’écologie des petits gestes ?
Oui, voilà ! Souvent, les gens se leurrent pas mal.
Sur le féminisme washing, les entreprises en ont été pas mal accusées à un moment donné.
[Là, Titiou, apparemment perturbée, interpelle le client à côté de nous, car elle a peur que le banc sur lequel il vient de s’asseoir tombe ; il remet le pied du banc en place, effectivement mal en point, et Titiou conclut par un « Voilà, je suis rassurée. »]
Donc, les entreprises. Ce qu’on a appelé du féminisme washing à un moment dans le monde de l’entreprise, c’est ce que l’on appelle maintenant le féminisme blanc bourgeois. Et j’ai l’impression que les deux se recoupent. On n’a pas fondamentalement changé les structures de pouvoir. On a fait des petites choses : il y a les journées de formation sur l’autonomie financière, par exemple, mais qui sont un peu saupoudrées. J’ai l’impression qu’on a davantage politisé le côté féminisme washing. Par ailleurs, il était question, à un moment, du sujet des mecs féministes.
Ces gens-là, justement, je n’arrive pas à savoir s’ils sont hypocrites ou s’ils ont l’impression de bien faire. Et de la même manière, que dire des femmes qui se disent féministes et qui nous assomment de discours qui ne font rien avancer ? Les uns comme les autres, faut-il les laisser faire ?
Oui, moi je trouve qu’il faut laisser faire et je trouve que cela rend visible, ne serait-ce que le mot « féminisme ». Je ne suis pas sûre que cela fasse du mal, donc je suis plutôt pour les laisser. On sait très bien que c’est aussi un effet de mode et que quand ce ne sera plus à la mode, elles ne seront plus là-dessus. Sur ces histoires de féminin sacré, de coach en développement personnel et les retraites, je ne sais pas si tu as vu, il y a un rapport de la Miviludes sur les sectes ; il y a un développement de courants sectaires qui sont là pour faire payer les femmes. Là, il y a quand même quelque chose de possiblement toxique, à surveiller.
Maintenant, plusieurs petites questions. Le prochain livre, donc, il est en cours d’écriture ?
Oui, j’ai même fini ! J’ai envoyé le texte final lundi. Il s’appelle La vie ressemble à ça, et il est sous forme de fragments. Il y a vraiment de tout, des textes un peu longs, des conseils de ménage pour mes enfants. Très étrange, tu vas voir.
C’est un essai, alors ?
Oui, c’est un essai, enfin, ce n’est pas de la fiction. C’est de la non-fiction, comme on dit.
À quand une biographie sur Simone de Beauvoir ?
Ah ! Pfff. Je ne peux pas écrire sur Castor, on est trop proches ! Je ne peux pas écrire sur elle !
Pourtant, j’ai adoré le Balzac ! J’ai adoré ce que tu as fait dans cette biographie.
Mais tu sais que c’est un de mes livres préférés de moi, et il représente mes plus basses ventes. Ce qui est drôle, c’est qu’il continue à exister, je continue à le vendre, il a son petit cercle.
Pour Simone de Beauvoir, c’est un peu plus compliqué. D’abord, elle a écrit ses mémoires, contrairement à Balzac, je ne vais pas re-raconter en moins bien ce qu’elle a déjà écrit. Ou alors il faut que j’apporte tout ce qu’elle n’a pas dit. Et ça, il y a une biographe de Beauvoir qui l’a fait, qui s’appelle Deirdre Bair, et qui a fait un truc absolument génial. Autant sur Balzac, il restait des choses que personne n’avait racontées, ou en tout cas, pas comme ça, autant sur Beauvoir… Oh, une merlette ! [Une merlette se pose non loin.] Donc voilà, je ne crois pas que je pourrais.
Est-ce que tu as le sentiment aujourd’hui que tout le monde sort des livres sur tout et n’importe quoi ? Est-ce que cela appauvrit les bons livres, essais ou romans, ou cela les fait-il sortir un peu de cette médiocrité ? Est-ce que cela doit nous encourager à écrire ou au contraire nous décourager ?
Il y a toujours eu ça. Après, sur les sujets de féminisme, je trouve qu’il y a plein de bouquins pas bons, et ça m’énerve, parce que je me dis qu’on mérite mieux… Un gros carton, c’est Mona Chollet, c’est super. Ses Sorcières, c’est très bien. Et j’ai l’impression que les livres pas très bons sur le féminisme ne se vendent pas très bien, donc finalement, je ne pense pas que cela desserve les autres livres. De toute façon, les maisons d’édition publient trop, et cela pose plein de problèmes économiques.
Si on t’en donnait le pouvoir, là tout de suite, qu’est-ce que tu ferais comme nouvelle loi ? Quel problème réglerais-tu, quelle injustice réparerais-tu ?
Là, tout de suite ? Oh là là, je ne sais pas du tout ! Après, tu sais, j’avais dit une fois, si Macron m’appelle et me demande, pour l’égalité femmes-hommes précisément, quelles seraient les trois mesures à prendre. Cela m’intéressait de me poser la question ainsi, parce que ça me force à être plus concrète. Qu’est-ce qu’on peut porter comme proposition politique ? D’abord une réforme de l’impôt, un impôt féministe ; je trouve ça hyper intéressant. Comment on re-répartit les richesses différemment ? Je pense qu’une réforme de l’impôt avec une déconjugalisation, ce serait quand même la chose à faire. La deuxième mesure, à laquelle je tiens beaucoup, concerne l’école. Je sais qu’on en demande beaucoup à l’école. J’aimerais beaucoup qu’à l’école, il y ait des cours d’éducation ménagère obligatoires, en primaire et au collège, pour les filles et les garçons. Ce qui va rejoindre ce qu’on disait tout à l’heure : quand on a fait l’égalité des programmes filles et garçons, on a mis les programmes des filles au niveau des garçons. Et comme ils n’avaient pas d’éducation ménagère, on a enlevé l’éducation ménagère. Mais non, il faut en mettre pour les garçons aussi. Si on considère que c’est un sujet politique, il faut s’en emparer. C’est un enjeu d’égalité. C’est aussi lié aux questions de normes de propreté qui ne sont pas les mêmes pour les filles et pour les garçons. Une petite fille n’a pas le droit d’avoir de taches ; un garçon qui en a, c’est admis. Il y a donc quelque chose à faire, et qui existe au Danemark. Ils ont des cours d’éducation ménagère obligatoires au collège et c’est même pire que ça : en même temps que le cours d’éducation ménagère, on leur lit des textes féministes. Autant dire qu’en France, on en est très loin. J’aimerais que cela permette aussi de rentrer sur le sujet de l’écologie, parce que c’est forcément lié. Et enfin, ce dont je me suis rendu compte, c’est dans mon prochain livre et cela m’intéresse beaucoup, c’est, par exemple, si on sort, autour de nous, est-ce que tu arrives à citer le nom de cinq plantes qu’on va croiser ? En fait, la plupart des gens ne connaissent pas l’environnement dans lequel on est. On ne peut pas reconnaître les oiseaux, reconnaître les plantes, etc. On en est absolument incapables. C’est comme si on vivait le monde qui nous entoure juste comme un décor de théâtre. Dans un livre pour enfants, quand ils dessinent un arbre, tu ne sais pas si c’est un boulot, un hêtre ou un chêne, tu t’en fous, c’est un arbre. Par l’école, j’adorerais qu’on nous apprenne l’environnement dans lequel on est, et ce ne serait pas le même programme selon les régions en France – et ça, on n’aime pas en France. Je parlais avec un responsable du bien-être animal dans une municipalité, et on parlait des rats, par exemple. Il m’apprenait plein de choses sur le comportement des rats, et je me disais qu’on devrait, nous, puisqu’on fréquente des rats et qu’on partage un environnement, savoir comment ils vivent et comment ils fonctionnent. Et on ne nous l’apprend pas du tout.
Éducation ménagère, compréhension de ton environnement et de tes interactions possibles, on revient sur la question écolo, j’adorerais imposer cela à l’école.
On vous connaît évidemment surtout comme féministe. Est-ce que cela vous résume bien ou êtes-vous très éclectique et est-ce par le féminisme que vous avez trouvé votre voie ?
Cela a toujours été un combat vraiment fondamental que ma mère m’a transmis. Et de fait, c’était l’inégalité que je pouvais vivre et constater. C’est compliqué d’être une femme qui écrit sans se poser la question du féminisme. Et puis il y avait Simone de Beauvoir, et d’autres. Donc cela a toujours été là. Mais quand je me projetais en train d’écrire, je me disais : « comme on est à l’égalité maintenant en France, je ne saurais pas écrire sur le féminisme parce que c’est fini tout ça. »
Cela a toujours été structurant pour moi. Et après, oui, je m’intéresse quand même à plein de choses. Quand je fais une biographie de Balzac, cela m’amuse aussi d’avoir un prisme féministe sur Balzac ; c’est plus rigolo que d’avoir un prisme féministe sur Beauvoir.
Concernant les réseaux sociaux, vous y êtes assez peu.
Si, je suis sur Insta !
Ah, oui, c’est moi le problème, je n’y suis pas du tout. Je me faisais la réflexion que quelqu’un comme Salomé Saqué avait une couverture médiatique plus importante ; elle me semble être mieux connue par le grand public.
Oui, oui. Mais on n’est pas de la même génération. Il y a aussi Camille Étienne. Et on n’est pas tout à fait sur les mêmes sujets. C’est marrant, parce que Salomé, je l’ai vue il n’y a pas très longtemps, et elle m’a dit que quand on s’était rencontrées il y a quelques années, je lui avais dit : « toi, tu vas faire des livres qui vont cartonner ». Je ne m’en souvenais pas du tout. Je savais que j’aurais dû être son agente et prendre un pourcentage ! Après, je trouve que Salomé, c’est particulier, parce qu’elle reçoit tellement de menaces de mort. C’est vraiment horrible et cela lui fait beaucoup de mal. Moi, je suis au degré de notoriété idéal. On va me reconnaître une fois par jour dans la rue, juste de quoi avoir un petit boost d’égo, mais ce ne sont jamais des adversaires. C’est impeccable. Je réfléchis, parmi les féministes… Il n’y en a pas tant que ça qui sont médiatiques. Salomé et Camille, elles sont quand même vraiment axées sur l’écologie.
Mais alors, c’est terrible, quand même, non, de faire le constat qu’il n’y en a pas beaucoup ?
Oui.
Un immense merci à Titiou Lecoq d’avoir accepté ma demande et de s’être prêtée au jeu de cette interview.
Sonia Corvi, pour Celles qui Osent
En attendant notre prochain article, n'oubliez pas de suivre notre podcast sur ces Femmes qui Osent