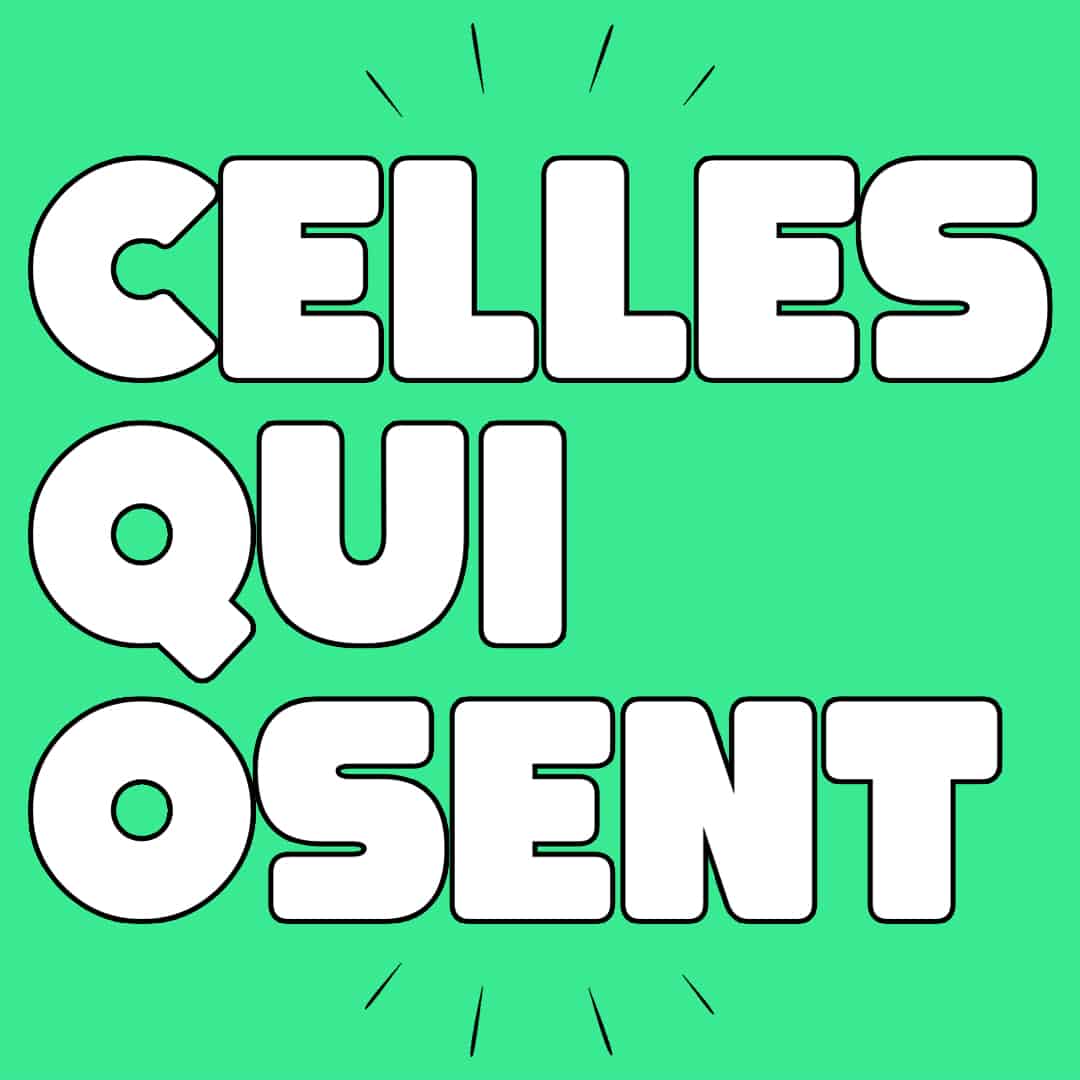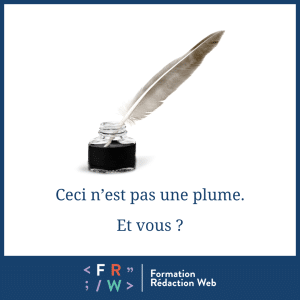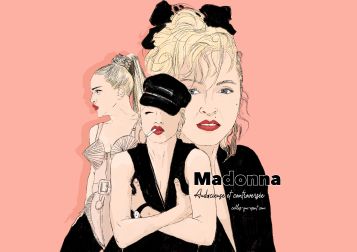Il y a dans nos sociétés modernes une étrange contradiction : nous vivons plus longtemps, nous avons repoussé les frontières de la médecine, nous parlons ouvertement de sexualité, d’argent, de politique, mais nous détournons encore les yeux devant l’inévitable. La mort, omniprésente dans les statistiques, dans les journaux, dans les fictions que nous consommons, reste pourtant un silence gêné lorsqu’il s’agit d’en parler pour nous-mêmes ou nos proches. C’est un paradoxe qui intrigue philosophes, psychologues et anthropologues depuis longtemps. Freud y voyait l’un des plus grands refoulements collectifs : « L’inconscient ne connaît pas la mort », écrivait-il, soulignant combien notre psychisme, pour se protéger, refuse d’intégrer l’idée de sa propre fin. Ce mécanisme d’évitement nous rassure au quotidien, mais il nous prive aussi de conversations parfois nécessaires.
Briser le silence sur la fin de vie : comprendre les racines du tabou
Dans la Grèce antique, la mort était pensée comme un sujet philosophique central. Épicure affirmait que « la mort n’est rien pour nous » : tant que nous sommes là, elle n’est pas, et lorsqu’elle arrive, nous ne sommes plus. Montaigne, des siècles plus tard, reprendra ce motif en affirmant que « philosopher, c’est apprendre à mourir ». Mais apprendre à mourir, c’est aussi apprendre à vivre — car l’acceptation de notre finitude éclaire nos choix, affine nos priorités, rend plus précieux chaque instant. Pourtant, nous préférons souvent tenir la mort à distance, comme si la nommer la rapprochait.
Les raisons de ce tabou sont nombreuses. Elles sont historiques : dans nos campagnes d’autrefois, la mort était visible, intégrée au quotidien. Les veillées funèbres se déroulaient à domicile, les enfants voyaient le corps, la communauté accompagnait les familles endeuillées. Progressivement, l’hôpital est devenu le lieu quasi exclusif de la fin de vie, coupant la mort du cadre familier. Elles sont culturelles et spirituelles : dans le christianisme, la mort est passage vers une autre vie ; dans le bouddhisme, elle participe d’une transition ; dans certaines traditions africaines, elle renforce l’appartenance aux ancêtres. Ces influences façonnent notre rapport à la fin de vie, entre préparation consciente et silence soigneux.
Elles sont enfin psychologiques : évoquer sa propre mort avec ses proches, c’est dévoiler sa vulnérabilité, et parfois risquer l’incompréhension ou la douleur.
L’anthropologue Philippe Ariès, dans Essais sur l’histoire de la mort en Occident, montre comment notre rapport à la mort s’est métamorphosé en quelques siècles. Ce qui était autrefois un événement collectif, visible, presque ritualisé au quotidien, est devenu un processus discret, souvent relégué aux institutions. Cette « mort interdite » contribue au malaise que nous ressentons aujourd’hui à son évocation.
Parler de la mort pour mieux vivre
Ernest Becker, dans The Denial of Death, écrivait que toute civilisation se structure sur le refus de la finitude. Nos œuvres, nos projets, nos idéaux : tout contribue à repousser l’angoisse existentielle. Lorsque cette angoisse jaillit, elle frappe plus fort si nous n’avons jamais appris à l’accueillir. Ne pas préparer les conditions de notre départ, ne pas exprimer nos volontés, c’est laisser à d’autres le soin de décider, souvent dans un moment de détresse. Ce poids, nous pouvons l’alléger. Des personnes ayant osé partager leurs choix funèbres témoignent d’un apaisement étonnant, d’une clarté retrouvée. Prévoir ses obsèques n’est pas céder à la fatalité, c’est exercer sa liberté jusqu’au bout, offrir une boussole à ceux qu’on laisse.
C’est dans cet esprit que l’on peut recourir à des outils concrets comme le contrat obsèques, qui formalise ses volontés (cérémonie, contenu, budget) pour garantir que l’on soit honoré comme on l’a souhaité. C’est à la fois un geste juridique et poétique, un dernier acte organisé, réfléchi, désiré.
Le sociologue Norbert Elias, dans La solitude des mourants, rappelle que la mort est devenue un événement de plus en plus solitaire dans les sociétés contemporaines. La réintégrer dans la conversation collective, c’est aussi réinscrire la fin de vie dans une dimension communautaire, dans la continuité d’un lien social et affectif.
Dans certaines villes nordiques, des initiatives citoyennes proposent même des « cafés mortels », où l’on se retrouve pour échanger librement sur la fin de vie, la transmission, les volontés. Ces lieux informels redonnent à la mort une place dans l’espace public, tout en désamorçant le poids émotionnel qui l’entoure.
Plusieurs psychologues et thérapeutes ont offert des repères précieux pour apprivoiser ce dont on ne parle guère. La psychiatre Elisabeth Kübler-Ross a popularisé un langage commun — déni, colère, marchandage, tristesse, acceptation — qui a permis à des millions de personnes de mettre des mots sur le chaos intérieur. On oublie pourtant qu’elle-même insistait sur le caractère non linéaire de ce chemin : il s’agit d’allers-retours, de vagues qui montent et redescendent, et non d’un escalier que l’on gravirait marche après marche. Cette intuition a été approfondie par la psychologue Margaret Stroebe, qui, avec Henk Schut, a décrit le « double processus » du deuil : on oscille entre des moments où l’on affronte la perte et d’autres où l’on se réengage dans la vie quotidienne. Ce va-et-vient normalise l’ambivalence : on peut rire le matin et pleurer le soir, avancer puis reculer, sans que cela traduise un “mauvais” deuil. Pauline Boss a, de son côté, conceptualisé la « perte ambiguë » : ces situations où l’absence est présente — un parent atteint d’une maladie neurodégénérative, un proche éloigné dont on ne sait plus comment le rejoindre. Elle montre combien les rituels, la parole partagée et la tolérance à l’incertitude apaisent la tension entre attachement et séparation. Pour les enfants, la psychologue Maria Nagy a mis en évidence que la compréhension de la mort se construit par étapes ; en parler tôt, avec des mots ajustés à l’âge, diminue l’angoisse et empêche les fantasmes d’envahir l’imaginaire. Therese Rando propose, elle, un cadre clinique pragmatique : reconnaître la réalité de la perte, accueillir les réactions, revisiter le lien, laisser partir ce qui ne peut plus être, se réajuster et réinvestir sa vie. En France, Marie de Hennezel rappelle, dans ses écrits sur l’accompagnement, que la fin de vie se traverse mieux lorsque la présence, la vérité et la dignité priment sur l’évitement ; parler, dire ce que l’on souhaite, décider de certains gestes à l’avance, ce n’est pas céder, c’est se rendre disponible à l’essentiel des derniers liens. À la lumière de ces apports, ouvrir la conversation et anticiper quelques choix — jusqu’à l’organisation de ses obsèques — revient à alléger la charge des proches et à redonner de la cohérence à ce qui, autrement, demeure confus et redouté.
Accepter notre mortalité, un art de vivre
Ceux qui improvisaient encore des funérailles très classiques auraient été étonnés de savoir que, dans l’Antiquité, des stoïciens pratiquaient le memento mori — se rappeler qu’on va mourir pour mieux vivre. Les méditations bouddhistes sur la mort ne sont pas morbides : elles réveillent la gratitude, l’attention au présent. Ces traditions nous enseignent une vérité simple : compter chaque jour comme précieux, aimer, oser, être présent. Rappeler sa finitude est un renouveau, une force. En parlant de la mort, on la transforme, on accepte la vie dans toute sa fragilité, et peut-être dans toute son audace.
De ce point de vue, oser cette conversation est aussi un acte social et politique : il interroge nos institutions, nos rites, notre rapport collectif à la vulnérabilité. En revendiquant le droit de choisir et de dire comment nous voulons partir, nous affirmons notre vision de la dignité humaine.
Celles qui Osent
En attendant notre prochain article, n'oubliez pas de suivre notre podcast sur ces Femmes qui Osent